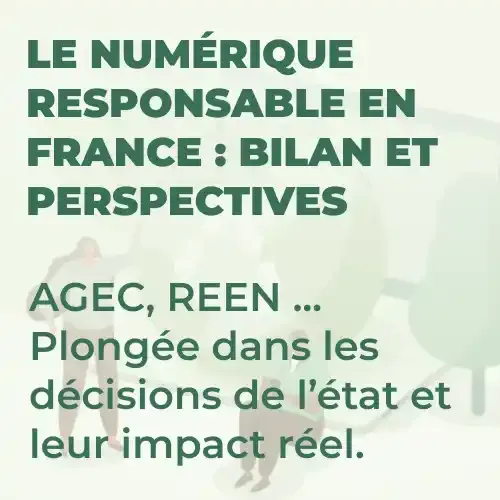
L'état du numérique responsable en France : bilan et perspectives
Le numérique responsable s'impose comme un enjeu majeur de la transition écologique française. Face à une empreinte carbone qui représente déjà 2,5% du total national et 10% de la consommation électrique annuelle, la France a développé un arsenal législatif et réglementaire ambitieux pour encadrer et réduire l'impact environnemental du secteur numérique. Cette transformation profonde implique tous les acteurs : entreprises, collectivités, citoyens et organismes de recherche.
Un contexte d'urgence environnementale
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sans action concrète, les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient augmenter de plus de 45% d'ici 2030. Cette perspective alarmante a motivé les pouvoirs publics français à placer le numérique responsable au cœur de leurs préoccupations. La prise de conscience sociétale s'est renforcée, notamment portée par les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat qui ont clairement exprimé cette demande.
La France bénéficie toutefois d'atouts structurels significatifs, notamment grâce à son électricité bas-carbone qui limite une partie de l'empreinte environnementale liée aux usages numériques. Le pays peut également s'appuyer sur un écosystème d'acteurs historiquement engagés, à l'instar de GreenIT, de l'association HOP ou du Shift Project.
Un cadre législatif structurant
La loi REEN : pierre angulaire de la régulation
La loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (REEN), adoptée le 15 novembre 2021, constitue le pilier de la stratégie française. Cette législation innovante s'articule autour de cinq objectifs clés qui transforment l'approche du numérique dans tous les secteurs.
Sensibilisation et formation : La loi impose l'intégration de modules de numérique responsable dans les cursus éducatifs, des écoles primaires aux formations d'ingénieurs. Ces dernières doivent désormais obligatoirement inclure des enseignements sur l'écoconception des services numériques et la sobriété numérique. L'article 4 prévoit également la création d'un observatoire des impacts du numérique pour améliorer la connaissance des effets directs et indirects sur l'environnement.
Limitation du renouvellement des équipements : En renforçant les dispositions de la loi AGEC, la REEN interdit formellement les pratiques d'obsolescence programmée, y compris logicielle. Les informations transmises aux consommateurs sur les mises à jour des biens numériques doivent être lisibles et compréhensibles. Les distributeurs ont désormais l'obligation d'informer les consommateurs sur les offres de reconditionnement et de fournir des conseils d'usage et d'entretien pour allonger la durée de vie des produits.
Promotion de l'économie circulaire : La loi organise des opérations nationales de récupération des équipements dormants. Cette mesure répond à un enjeu considérable : entre 54 et 113 millions de téléphones dorment dans les tiroirs des Français selon une étude de l'Afnum. L'article 16 prévoit que les anciens équipements informatiques des services de l'État et des collectivités soient orientés vers le réemploi ou la réutilisation.
Adoption d'usages écoresponsables : Un référentiel général d'écoconception doit être créé pour fixer des critères de conception durable et réduire l'empreinte environnementale des services numériques. Une recommandation spécifique sera publiée concernant l'impact environnemental de la vidéo en ligne, secteur particulièrement énergivore.
Optimisation des infrastructures : Les centres de données font l'objet d'un renforcement des conditionnalités environnementales pour bénéficier du tarif réduit de la TICFE. Les mesures de réutilisation de la chaleur fatale et de limitation de la consommation d'eau à des fins de refroidissement sont désormais valorisées. Les opérateurs de communications électroniques doivent publier des indicateurs clés récapitulant leurs engagements en faveur de la transition écologique.
La loi AGEC : pionnière de l'économie circulaire numérique
Adoptée le 10 février 2020, la loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire a introduit des mesures révolutionnaires qui préfigurent l'approche française du numérique responsable.
L'indice de réparabilité, obligatoire depuis le 1er janvier 2021 sur les téléviseurs, ordinateurs, smartphones et certains appareils ménagers connectés, constitue une innovation mondiale. Cette note sur 10 informe les consommateurs sur la facilité de réparation des produits et sera remplacée par un indice de durabilité au 1er janvier 2024, intégrant des critères de fiabilité et de robustesse.
La loi impose également aux fabricants et vendeurs de communiquer la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles sont fournies, et oblige la fourniture de pièces détachées pendant au minimum 5 ans pour les petits équipements informatiques et de télécommunications.
Pour le secteur public, la loi AGEC introduit des obligations d'exemplarité : depuis le 10 mars 2021, l'État, les collectivités et leurs groupements doivent acquérir certains biens issus du réemploi ou de la réutilisation. L'administration publique doit également favoriser l'utilisation de logiciels dont la conception limite la consommation énergétique.
L'impact transformateur sur les entreprises
Obligations légales et réglementaires
Les entreprises françaises font face à un corpus législatif de plus en plus exigeant en matière de numérique responsable. Au-delà des lois REEN et AGEC, elles doivent composer avec le RGPD qui impose des obligations strictes de protection des données, incluant la tenue d'un registre des traitements et la minimisation de la collecte de données.
Les fournisseurs d'accès internet ont l'obligation, depuis le 1er janvier 2022, d'informer leurs abonnés de la quantité de données consommées et d'indiquer l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Cette mesure de transparence révolutionnaire transforme la relation avec les consommateurs.
Opportunités stratégiques et compétitives
Pour les entreprises, le numérique responsable représente bien plus qu'une contrainte réglementaire. Il constitue un levier stratégique de différenciation et d'innovation. Les entreprises qui adoptent précocement des pratiques de réemploi pour leurs équipements informatiques prennent une longueur d'avance sur leurs concurrents.
La loi REEN encourage explicitement cette approche en prévoyant que les achats publics prennent en compte l'indice de réparabilité dans la passation des marchés. Cette disposition crée un avantage concurrentiel pour les entreprises proposant des solutions durables.
Transformation des modèles économiques
Le numérique responsable pousse les entreprises vers de nouveaux modèles économiques, notamment l'"économie de la fonctionnalité" et les approches "low-tech". Ces modèles privilégient l'usage au lieu de la possession et favorisent le développement de biens et services "au juste besoin".
Les entreprises doivent désormais intégrer trois dimensions dans leur stratégie : la réduction de leurs propres émissions de GES liées au numérique, l'utilisation du numérique comme levier de réduction d'impact dans d'autres secteurs, et le développement d'innovations numériques responsables.
Défis organisationnels et humains
La mise en œuvre du numérique responsable nécessite une transformation culturelle profonde des organisations. Les entreprises doivent former leurs équipes, repenser leurs processus d'achat et développer de nouvelles compétences en écoconception et sobriété numérique.
L'ADEME, à travers son programme Alt Impact, accompagne cette transformation en aidant les entreprises à se former à la sobriété numérique et à mesurer l'impact environnemental du numérique au sein de leurs organisations.
L'Institut du Numérique Responsable : acteur de référence
Origines et mission
L'Institut du Numérique Responsable (INR) occupe une position centrale dans l'écosystème français du numérique responsable. Créé en 2018 sous la forme d'une association loi 1901, l'INR émane de la transformation du Club Green IT, élargissant sa mission aux problématiques sociales et éthiques au-delà du seul impact environnemental.
L'INR se définit comme un "think and do tank" dont l'ambition est d'être créateur de valeurs durables. Son action s'articule autour de trois champs de réflexion fondamentaux : la réduction de l'empreinte (environnementale, sociale et économique) du numérique, la capacité du numérique à réduire l'empreinte de l'humanité, et la création d'innovation numérique responsable pour favoriser l'e-inclusion de tous.
Approche méthodologique
L'INR développe une coopération interdisciplinaire étroite entre acteurs de la vie civile, de l'économie sociale et solidaire, enseignants, chercheurs, acteurs publics, privés et associatifs. Cette approche collaborative permet l'anticipation et l'appropriation des enjeux et des valeurs d'un numérique responsable.
L'action de l'institut est guidée par le principe des 3P (People, Planet, Profit), rappelant que les organisations doivent penser leur développement non seulement pour être viables économiquement, mais aussi en fonction des enjeux sociaux et d'urgence climatique.
Programmes de formation et certification
L'INR a développé l'Académie NR, plateforme de programmes de formation destinée aux professionnels et au grand public. Le MOOC Numérique Responsable, programme complet de 4h30, permet de maîtriser les fondamentaux et de préparer le passage du certificat de connaissance exigé dans le cadre de la labellisation NR niveau 1.
Cette certification devient un enjeu stratégique pour les entreprises souhaitant démontrer leur engagement et leur compétence en matière de numérique responsable. Le MOOC couvre les connaissances théoriques essentielles et prépare les participants à intégrer concrètement ces principes dans leur pratique professionnelle.
Impact sur l'écosystème
L'INR rassemble aujourd'hui un réseau de plus de 18 000 abonnés sur LinkedIn, témoignant de l'engagement croissant des professionnels sur ces sujets. L'institut joue un rôle d'accélérateur en créant des ponts entre la recherche, l'industrie et les politiques publiques.
Son approche holistique, intégrant dimensions environnementale, sociale et économique, permet de dépasser les approches purement techniques pour aborder le numérique responsable comme un enjeu de société. L'institut contribue ainsi à définir les standards et bonnes pratiques qui irriguent progressivement tout l'écosystème.
Des objectifs territoriaux ambitieux
La stratégie française ne se limite pas aux mesures nationales. La loi REEN impose aux communes de plus de 50 000 habitants de définir une stratégie numérique responsable avant le 1er janvier 2025. Le décret n° 2022-1084 du 29 juillet 2022 précise le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration.
Cette territorialisation de l'action publique crée un maillage dense d'initiatives locales, permettant d'adapter les mesures aux spécificités de chaque territoire. Les collectivités deviennent ainsi des laboratoires d'expérimentation et de diffusion des bonnes pratiques.
Une gouvernance renforcée
Le Haut Comité pour le Numérique Écoresponsable
Lancé en novembre 2022, le Haut comité pour le numérique écoresponsable (HCNE) constitue l'organe de pilotage de la planification écologique sur le sujet du numérique responsable. Co-présidé par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, il réunit l'ensemble des parties prenantes : entreprises, fédérations professionnelles, ONG, représentants des collectivités territoriales et chercheurs.
Le HCNE assure le pilotage de l'ensemble des travaux menés en matière de numérique responsable, garantissant la cohérence des actions et l'implication de tous les acteurs concernés.
La feuille de route gouvernementale
La feuille de route "Numérique et Environnement", rendue publique en février 2021, constitue le cadre de référence de l'action publique. Elle s'articule autour de trois axes stratégiques :
Connaître pour agir : Il s'agit d'apporter des données précises et objectives sur les impacts positifs et négatifs de l'ensemble du cycle de vie des services numériques. Cette approche multicritère intègre les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et de ressources matières.
Soutenir un numérique plus sobre : Face aux projections de forte croissance des usages numériques, l'objectif est de maîtriser, voire de réduire, l'empreinte environnementale du numérique, liée tant à la fabrication des équipements qu'aux usages.
Faire du numérique un levier d'innovation pour la transition écologique : Le numérique permet déjà d'optimiser la consommation d'énergie, de réduire les déplacements et de mieux gérer les déchets. Il s'agit de s'appuyer sur ce potentiel pour accélérer la transition écologique.
L'innovation au service de la transition
La stratégie France 2030
La stratégie d'accélération "Numérique écoresponsable" de France 2030 représente le volet financier et d'investissement de la politique générale. Elle vise à concilier transition numérique et environnementale en développant l'écoresponsabilité du secteur tout en créant une offre compétitive plus sobre.
Cette stratégie s'articule autour de quatre axes et douze mesures : soutien aux développements méthodologiques, innovation pour l'économie circulaire, création d'une offre de formation continue et initiale, et accompagnement des acteurs dans leur transformation.
L'appel à projet Econum
Lancé en juillet 2023 et opéré par l'ADEME, l'appel à projet Econum vise à faire émerger des projets innovants pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Il se concentre sur trois axes : l'écoconception des biens et services numériques, le réemploi et le reconditionnement, et les modèles de production responsables.
Les quatre premiers lauréats illustrent la diversité des approches : TNRS (Territoires Numériques Résilients et Solidaires) pour lutter contre la précarité numérique, PLUG IA pour des boîtiers intelligents éco-conçus, le reconditionnement des appareils Apple par Okamac/Sens Technologies, et REPEX pour l'effacement sécurisé des données par rayons X.
La feuille de route de décarbonation
L'article 301 de la loi Climat et résilience impose l'établissement d'une feuille de route de décarbonation pour chaque secteur fortement émetteur. Bien que le numérique ne soit pas formellement défini comme tel dans la Stratégie nationale bas carbone, l'importance croissante de ses émissions a conduit à l'élaboration d'une feuille de route spécifique.
Les travaux, débutés fin 2022, ont abouti en juillet 2023 à une première proposition élaborée par les acteurs de la filière. Cette proposition contribuera à l'élaboration d'un objectif d'évolution de l'empreinte carbone du numérique et d'un plan d'action pour la prochaine SNBC.
Les enjeux européens et internationaux
La France s'inscrit dans une dynamique européenne plus large avec dix réglementations clés qui façonnent le numérique responsable :
Protection des données et transparence : Le RGPD, entré en vigueur en mai 2018, et la loi Informatique et Libertés renforcée encadrent strictement la collecte et l'utilisation des données personnelles.
Régulation des plateformes : Le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), adoptés en 2022, s'attaquent respectivement aux dérives des grandes plateformes et aux pratiques anticoncurrentielles des "gatekeepers".
Normes environnementales : Les directives RoHS (substances dangereuses), Batterie (gestion du cycle de vie des batteries), et EcoDesign (efficacité énergétique) fixent des standards environnementaux stricts pour les équipements électroniques.
Approche française globale : La loi Climat et Résilience complète ce dispositif en promouvant la sobriété numérique et la sensibilisation à l'impact écologique des usages digitaux.
Les résultats contrastés de 2024
Malgré ce cadre ambitieux, les résultats de 2024 révèlent un tableau nuancé qui met en lumière l'écart entre les ambitions réglementaires et la réalité de terrain.
Sensibilisation encore insuffisante
Le baromètre 2024 du numérique responsable révèle des lacunes importantes : 49% des salariés déclarent n'avoir jamais entendu parler du numérique responsable, et 48% des entreprises n'ont jamais réalisé de bilan carbone. Ces chiffres témoignent du chemin qui reste à parcourir pour diffuser la culture du numérique responsable.
Engagement progressif des entreprises
Néanmoins, l'engagement des entreprises du secteur numérique envers le développement durable s'est renforcé. Le plan de sobriété énergétique du groupe de travail numérique a permis d'identifier des voies d'économies concrètes :
- Limitation de la climatisation dans les centres de données (passage de 21°C à 23°C pour économiser 7 à 10% d'énergie)
- Paramétrage optimisé des box internet et décodeurs TV (une box consomme en moyenne 158 kWh par an)
- Quantification des consommations énergétiques des services les plus énergivores
- Engagement des entreprises à réaliser leur bilan carbone et à rejoindre "L'Engagement sobriété"
Défis de mise en œuvre
Le premier comité de suivi des parties prenantes, organisé en juillet 2023, a permis de faire un état des lieux de l'engagement des entreprises. Des indicateurs de suivi ont été développés pour les filières terminaux, centres de données, services numériques et réseaux. Les premiers résultats attendus permettront d'évaluer l'avancement des engagements pris.
Perspectives et défis futurs
L'intelligence artificielle, nouveau défi
L'émergence de l'intelligence artificielle pose de nouveaux défis environnementaux encore peu encadrés par la législation. L'IA a un impact environnemental considérable, notamment en termes d'émissions de CO₂ et de consommation hydrique par ses infrastructures de calcul intensif et de stockage de données.
L'AI Act européen, en cours de négociation, constitue une première réponse globale à ces enjeux. Cependant, les réglementations spécifiques sur l'empreinte écologique de l'IA restent limitées, créant un angle mort dans l'approche actuelle du numérique responsable.
Vers une approche holistique
Le numérique responsable ne pourra se réaliser pleinement qu'en prenant en compte la pollution engendrée par toutes les nouvelles technologies. Les prochaines étapes de la régulation seront essentielles pour accompagner la transition vers un numérique durable, tout en limitant l'impact environnemental croissant des innovations.
Mesure et évaluation
La feuille de route de décarbonation du secteur numérique, élaborée en 2023 avec l'ensemble des acteurs de la filière, doit maintenant se concrétiser par des actions mesurables. Le défi consiste à transformer les engagements volontaires en résultats concrets et vérifiables.
Un système d'indicateurs robuste est en cours de développement pour suivre l'évolution de l'empreinte carbone du secteur et mesurer l'efficacité des politiques mises en place.
Conclusion
La France a posé les bases d'un cadre réglementaire ambitieux et pionnier pour le numérique responsable, avec des lois innovantes comme la REEN et un écosystème d'acteurs engagés, illustré par le rôle central de l'Institut du Numérique Responsable. Cette approche holistique, intégrant dimensions environnementale, sociale et économique, place le pays en position de leader mondial sur ces enjeux.
Cependant, le passage de la réglementation à la mise en œuvre effective reste un défi majeur. L'écart entre les ambitions affichées et la réalité de terrain, révélé par les enquêtes de 2024, souligne la nécessité d'intensifier les efforts de sensibilisation et d'accompagnement.
Pour les entreprises, le numérique responsable représente une transformation stratégique majeure qui va bien au-delà de la simple conformité réglementaire. Il s'agit d'une opportunité de repenser les modèles économiques, d'innover et de se différencier sur des marchés de plus en plus exigeants.
L'enjeu des prochaines années sera de transformer ces obligations légales en pratiques concrètes et durables, en mobilisant tous les acteurs autour d'une vision partagée : faire du numérique un levier de la transition écologique plutôt qu'un frein, en maîtrisant son empreinte environnementale tout en exploitant son potentiel d'optimisation énergétique et de réduction des impacts dans d'autres secteurs.
Le succès de cette ambition dépendra de la capacité collective à allier innovation technologique et sobriété numérique, en s'appuyant sur un écosystème d'acteurs compétents et engagés, dont l'Institut du Numérique Responsable constitue un pilier essentiel. La France dispose des atouts nécessaires pour réussir cette transformation, mais elle nécessite une mobilisation soutenue de tous les acteurs dans la durée.